Numérique et climat : où sont les données ?
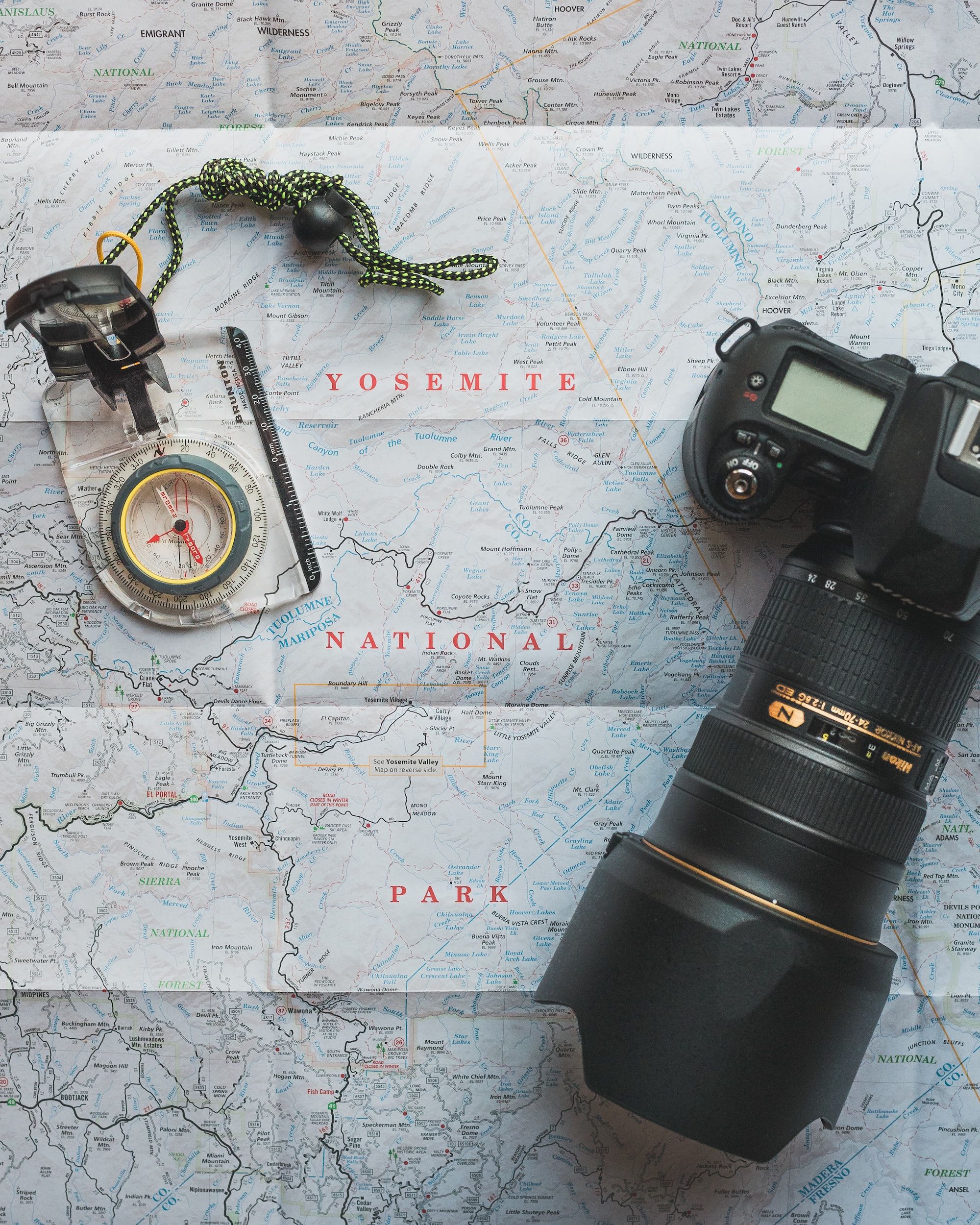
Cet article fait partie d’une série posant la question : quelle est la place du numérique dans un monde bas carbone ?
Introduction
Dans le numérique, les données correspondent au nerf de la guerre. Sans elles, nous ne pouvons pas comprendre l’impact du domaine sur le climat et l’environnement en général. Dès lors, toute action serait un tâtonnement en espérant aller dans la bonne direction. Ne soyez pas étonnés en voyant certains débats sur l’empreinte carbone des mails ou de la vidéo : la plupart des personnes n’en savent rien, car là est le problème, nous manquons de données. Voilà où nous en sommes dans le domaine du numérique: au début.
Des initiatives
Des initiatives ont eu lieu comme NegaOctet (voici une partie gratuite : base impact), un référentiel pour permettre de mieux comprendre et de réduire l’impact environnemental de différents produits ou services numériques. Un autre référentiel est celui de la base carbone de l’ADEME. Ce dernier est constitué d’un ensemble de coefficients qui permettent, une fois multiplié par la quantité souhaitée, de retrouver un ordre de grandeur des émissions de GES émises.
Une mauvaise compréhension du sujet dans le débat public
Il est important de s’attarder un instant sur ces chiffres. Ils sont souvent utilisés à tort et à travers dans le débat public. Il y a d’ailleurs un réel travail de vulgarisation à apporter afin de changer les habitudes de tous de façon raisonnée, organisée et dépassionnée.
L’ADEME avait publié une première estimation en 2011 de l’empreinte carbone d’un mail, avec ou sans pièce jointe. Cette dernière pouvait aller jusqu’à 50 gCO2e (gramme équivalent CO2) et des phrases chocs en découlaient comme “cela [l’utilisation quotidienne des mails par un salarié moyen] représente 13,6 tonnes équivalents CO2, soit 13 allers-retours Paris New York”.
Les calculs ont été actualisés au vu des nouvelles données et nous parlons de 4 gCO2e pour un mail simple tandis qu’il s’agirait de 35 gCO2e avec pièce jointe.
Mon avis ? Il s’agit d’estimations grossières qui sont sujettes à des interprétations fausses pour le grand public. Même le nouveau chiffre est donné avec une incertitude de 100% par l’ADEME. Se mettre d’accord que les entreprises ont du travail pour optimiser leurs systèmes d’information (comme par exemple la messagerie avec l’envoi de mail à des dizaines de destinataires qui ne sont pas concernés) est une chose, mais utiliser ce chiffre avec une énorme incertitude pour le multiplier par le nombre d’emails qui transitent chaque jour ne fait qu’apporter du bruit dans le débat public.
Tous les modèles sont faux, beaucoup sont utiles, certains sont mortels.
(Nassim Nicholas Taleb, Skin in the Game)
Nous sommes relativement précis sur la connaissance de la consommation électrique des systèmes et c’est déjà une première étape. Nous savons aussi qu’il faut minimiser notre consommation énergétique, qui doit au passage être la plus décarbonée possible.
Néanmoins, déterminer l’empreinte carbone en se basant sur celle des réseaux ainsi que des terminaux et de toute la pile logicielle ne fait qu’additionner les incertitudes. Il s’agit d’un calcul très complexe, d’autant plus qu’il est mondialisé et que les données des constructeurs sont souvent confidentielles. Ce ne sont d’ailleurs pas que les usages qui sont à remettre en question, mais encore une fois les sources d’énergies primaires qui permettent de produire l’électricité (cf. mix électrique Français par rapport au Chinois). Il est dès lors souhaitable de prendre les résultats avec des pincettes.
Des recherches plus poussées sont en cours
La critique étant faite, il est vital qu’un travail de recherche soit continué et poussé au maximum pour que tous les acteurs se mettent dans le bon sens de la marche avec une cadence plus rapide.
Ce domaine de la recherche est d’ailleurs l’un des chevaux de bataille de la loi REEN (cf. précédent article) qui prône le développement d’un observatoire des impacts environnementaux du numérique auprès de l’ADEME et de l’ARCEP.
Conclusion
La recherche de données fiables et exploitables est nécessaire pour atteindre nos objectifs. En effet, nous pouvons décomposer la décarbonation en 3 étapes : établir une comptabilité carbone, conseiller pour prendre des décisions adaptées au cas par cas pour enfin implémenter les solutions préconisées. Les données ont un rôle sur tous les maillons de la chaîne, notamment les deux premiers. La comptabilité carbone est un sujet en partie traité dans le précédent article avec de nombreux acteurs en France (Greenly, Sami, HelloCarbo ou Greenmetrics qui est focalisé sur le numérique).
Dans un prochain article, nous parlerons des solutions que nous pouvons effectuer afin de faire notre part en tant que citoyen, mais aussi des projets qui peuvent être entrepris au sein des entreprises de manière à traquer et réduire cette dépendance au carbone.